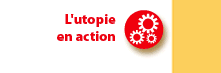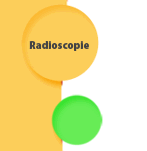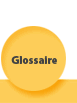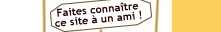Comment as-tu connu Culture et Liberté ?
En 1972, j’étais technicien machiniste au « Palace » (théâtre parisien). Depuis 68, avec quelques copains, on avait créé le « Théâtre du Levant », c’est là que je me suis formé à l’expression. Je connaissais Colette SOMMIER, permanente de Culture et Liberté Ile de France. Elle intervenait dans des Foyers de Jeunes Travailleurs. Un jour, Colette m’a demandé de la remplacer pour une intervention en expression à Athis-Mons. Là, j’ai rencontré Antoine LEJAY et Jean MARQUET. Je leur ai parlé de ce qu’on faisait au Théâtre du Levant depuis 1968. Antoine était emballé. Nous commençons à travailler ensemble dans une action de quartier à Nemours. Je découvre Culture et Liberté, ses textes : le rapport d’orientation de 1972, son approche de la « culture » et du « système éducatif » J’y adhère complètement. Cette vision de la culture rejoint les valeurs familiales (personnalisme de Mounier) et donne une réponse existentielle au jeune militant abandonnant en 68 les circuits traditionnels du théâtre * pour un théâtre militant qui accompagne les luttes et les populations. J’adhère à Culture et Liberté, j’y suis bénévole, j’interviens en Ile de France. En 1974, je deviens salarié à mi-temps et je vais faire la formation de militants à l’INFAC. (formation qu’on a faite ensemble ).
Comment ça a continué ?
Pour moi, il y a plusieurs temps.
Je suis d’abord « intervenant en expression » dans les Foyers de jeunes travailleurs en Ile de France, puis au National dans des stages d’une semaine (c’était le rythme à l’époque) et surtout dans des formations de formateurs. Culture et Liberté pensait alors, dans la logique « tous formés tous formateurs », qu’il était assez astucieux de donner aux militants de Culture et Liberté les moyens techniques d’intervenir en expression et en économie. On va mettre en place des stages et une « formation de formateurs en expression ». Au même moment, Gérard ROUSSEL mettait en place la « formation de formateurs en économie ». Deux piliers : donner aux travailleurs les capacités à s’exprimer et à comprendre le modèle socio-économique dans lequel ils vivent.
Dès 1974, Culture et Liberté National va passer avec le Théâtre du Levant une convention annuelle. Le Levant assure, à la fois, des stages en expression et utilise le théâtre dans les actions de Culture et Liberté.
1978 : Je deviens salarié du Levant et bénévole à Culture et Liberté. Avec le théâtre, nous intervenons pour accompagner les actions dans les quartiers ou dans les entreprises. Cette convention nous a permis par exemple, d’accompagner plusieurs mois le conflit des femmes de la CIP à Haines la Bassé (Pas de Calais). Des ouvrières du textile occupaient leur usine, produisaient des chemises et les vendaient. Elles luttaient pour empêcher la fermeture de leur entreprise. Nous les avons aidées à créer une pièce de théâtre pour expliquer leur lutte et la populariser.
Il va y avoir une montée en puissance de ces actions jusqu’en 1981. Cette année là, je deviens administrateur de Culture et Liberté National au nom de l’Ile de France.
Vivre à Grenoble
Avec l’arrivée de Mitterrand, il y a une période de flou. Au lendemain du congrès de Lille la convention est dénoncée et le Théâtre du Levant s’interroge sur sa stratégie. En 1983, je quitte « Le Levant » pour des raisons personnelles, et je vais vivre à Grenoble avec Claire.
A Culture et Liberté en Isère, à cette époque, il y avait Hugues Batsal et Richard Vitalis, Assez vite, je suis embauché comme secrétaire général local. Nous conduisons des formations avec le CIFBA ; avec l’Union Départementale CFDT et nous créerons une pièce de théâtre sur la place des femmes. Et surtout, à ce moment, il va y avoir une action nouvelle avec les Comités d’Entreprises (C.E.). Les TUC (Travaux d’Utilité Collective) se mettent en place. Quinze jeunes sont embauchés par des C.E. sous le statut de TUC. Ils reçoivent 500 Fr de l’état et un complément de revenu par le C.E. Ils font un mi-temps au CE et un autre mi-temps en formation avec Culture et Liberté. On expérimente quelque chose qui articule de l’économique et de la solidarité. A la fin de la formation, les jeunes sont tous embauchés par leur CE.
En 1987, le congrès national de Culture et Liberté a lieu à Grenoble. On y a fait, en ouverture, une « Journée des Initiatives » rendant compte d’actions des associations qui entreprenaient « autrement », on ne parlait pas encore à cette époque de l’économie solidaire.
Au Congrès d’Angers, Culture et Liberté décide de s’investir dans les dispositifs d’insertion. Je suis élu alors secrétaire général national. On a un savoir-faire, des expériences avec les Foyers de Jeunes Travailleurs, avec les TUC. On sait que l’insertion, ce n’est pas apprendre à faire des C.V., mais s’exprimer, s’organiser collectivement,…on avait mis en place le dispositif « Marchepied pour l’emploi », car on pensait sincèrement que notre travail d’éducation populaire devait nous rapprocher des gens exclus. En 1990, au congrès d’Angers, le rapport d’orientation intitulé « Lutter contre l’exclusion » a été adopté par plus de 80% de voix. Malgré cela, « Marchepied pour l’emploi » s’avéra être une fausse piste. L’erreur fut sans doute de mélanger exclusion et exploitation…. Nous avons été utilisés par les pouvoirs publics. (cf ; « Trilogie d’un mensonge entretenu »).
En 1993-94, c’est la crise à Culture et Liberté. Il y a crise des dispositifs et crise financière, Après le congrès d’Albi, il y aura tout le travail d’analyse et de sortie de crise à partir de l’Université d’été de Piriac. A cette époque, j’ai apprécié le travail avec Bruno DURIEZ, Luc CARTON. Je finis mon mandat en 1996, avec quelques désillusions et aussi des souvenirs de fidélités fortes. J’ai maintenant quatre enfants.
La suite… J’entreprends, financée en partie par UNIFORMATION, la formation « Science Po » à Grenoble. C’est pour moi un grand moment. Je n’avais plus fait d’études au delà du BAC et je me suis aperçu que j’ai appris plein de choses par mon action. Au cours de ces deux années d’études, je vais apprendre à organiser ma pensée. Ce sera pour moi un grand moment.
A 50 ans, diplômé, je ne trouve pas de travail sur Grenoble : « trop vieux, trop cher, trop formé, trop… » Je reste un an et demie au chômage. Finalement je suis embauché par « Vie Nouvelle » sur un poste national. « Vie Nouvelle », c’est une organisation qui véhicule les valeurs de mon milieu d’origine (la famille « personnaliste » de mon père), des gens engagés, au moment de la guerre d’Algérie, ni communistes, ni capitalistes, à la recherche d’une autre voie. J’y resterai 3 ans. On m’informe que les Foyers Ruraux cherchent un permanent pour le secteur action culturelle. C’est mon truc, j’y vais… .
Culture et Liberté et toi ?
Ma rencontre avec Culture et Liberté arrive à un moment où j’ai déjà eu des expériences dans les mouvements de jeunesse. Aux Scouts de France, j’ai participé à une campagne contre la faim. Il y a aussi le théâtre : jeux d’acteurs et mise en scène. En 1966, Sophocle, en 1967, la Cantatrice Chauve, Antigone,… On avait réussi à faire venir 600 personnes. Les événements de mai 68 nous ont permis une interrogation sur l’utilisation du théâtre.
La rencontre avec Culture et Liberté a été une rencontre fondamentale. J’adhère déjà à sa définition de la culture ; l’engagement dans l’action culturelle est mon combat. Je ne crois pas depuis longtemps déjà que les politiques culturelles liées à la diffusion culturelle, avec sa cohorte de mesures pour la « médiation culturelle » soient pertinentes. Je préfère parier sur la capacité des politiques culturelles à permettre à tout un chacun de se confronter à une pratique artistique et à un cheminement dans la création. Tout le monde a le droit à cela. La diffusion, la rencontre avec les grandes œuvres ? Ça vient après, en plus...
Mon engagement à Culture et Liberté s’inscrit dans un projet de vie.
Un truc fort dont tu te souviens ?
C’est lorsque en 1981, Michel MARCON, secrétaire général de Culture et Liberté, demande au Théâtre du Levant de faire le rapport d’orientation de Culture et Liberté sous la forme d’une pièce de théâtre. Nous avons présenté la pièce au congrès de Lille : « le buffet de la gare », Cela se passait dans un buffet de la gare en arrière du front « des luttes » et là se rencontraient les « soldats », le fantassin était le syndicaliste, l’aviateur, le politique-État et le résistant (celui qu’on ne voit pas) était le militant culturel.
La collaboration entre des artistes engagés et un mouvement d’éducation populaire est pour moi une grande richesse que j’ai apprise à Culture et Liberté. L’expression théâtrale au service d’un mouvement…une excellente coopération, concrétisée par une œuvre qui la sacralise.
Ce qui est exceptionnel : l’audace des fondateurs, Lejay, Bégassat, Belleville, Tamburini. C’est la prise de risque lorsqu’ils misent sur notre troupe de théâtre, mais ce sont aussi les formidables collaborations avec les équipes de Culture et Liberté, que ce soit à Cholet, à Nantes, à Brest, à Paris, à Lille et partout ailleurs. Un vrai travail de pionniers. Quand je vois aujourd’hui l’importance que prend le théâtre de rue et aussi la collaboration entre artistes et population, je me dis décidément que quand tout cela a commencé en 1974, vraiment Culture et Liberté a ouvert des portes inimaginables. Lorsque dans les Comités d’Entreprise, nous intervenions « entre midi et deux » dans les bibliothèques (à la Thomson par exemple) pour porter spectacle et discussion, nous étions loin devant. Mais manquaient et manquent toujours les moyens et la reconnaissance… Mais après tout…
Témoignage recueilli par Paul Masson en mai 2008